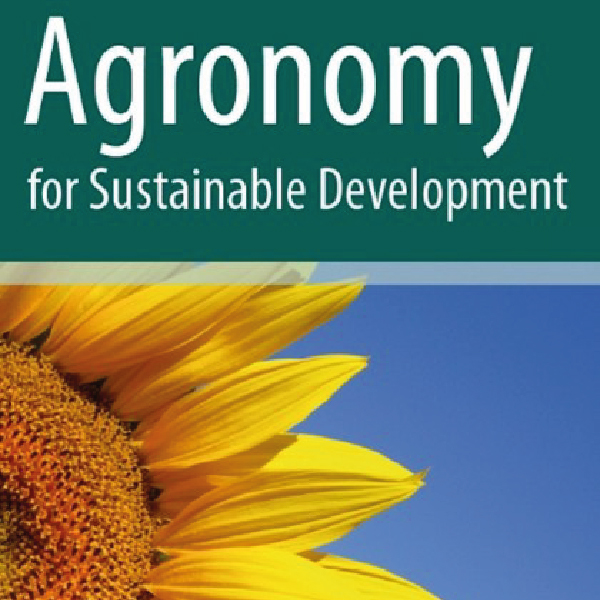Soil phosphorus budgets in organic farming differ according to plot managements and farm types
Pietro Barbieri · Josephine Demay · Morgan Maignan · Thomas Nesme · Gregory Vericel
Agronomy for Sustainable Development, 2025
Dans un article publié en 2025 dans Agronomy for Sustainable Development (Soil phosphorus budgets in organic farming differ according to plot managements and farm types), une équipe scientifique associant Bordeaux Sciences Agro, INRAE et Arvalis a étudié les bilans de phosphore (P) du sol dans des parcelles appartenant à 177 fermes françaises conduites en agriculture biologique. Leur objectif : mieux comprendre comment les pratiques de fertilisation et les types de fermes influencent la durabilité de la fertilité des sols.
Contexte : l’enjeu central du Phosphore
En agriculture biologique, l’apport de nutriments repose sur les fertilisants organiques et l’intégration de légumineuses dans les rotations. Si l’azote peut être assuré via la fixation symbiotique, la gestion du phosphore demeure plus complexe : sources limitées, coûts élevés, transport difficile, solubilité faible. Or, les stocks de P du sol évoluent sur le long terme, et leur appauvrissement peut compromettre la productivité. Pourtant, 72 % des agriculteurs interrogés ne déclarent pas prêter une attention particulière à la gestion du phosphore.
Principaux résultats
Dans ce travail, des bilans de P du sol ont été calculés sur cinq ans et combinés à des analyses de sols. Les résultats montrent des situations très contrastées : les bilans annuels varient de -32,3 à +50,3 kg Pha-1 an-1, avec une moyenne proche de l’équilibre (+1,7). Plus de la moitié des parcelles présentent toutefois un bilan négatif, signe d’un risque d’appauvrissement des sols. Les deux principaux facteurs explicatifs sont les apports cumulés de phosphore (39 % de la variabilité expliquée) et la fréquence des cultures fixatrices d’azote (légumineuses), souvent associée à des bilans négatifs.
Une analyse de regroupement a notamment permis d’identifier trois grands systèmes :
- Les fermes sans élevage, très peu fertilisées avec des bilans P négatifs.
- Les exploitations utilisant fortement le fumier de volaille importé, avec des bilans P très positifs.
- Les systèmes mixtes avec fumier produit sur l’exploitation qui ont des bilans proches de l’équilibre.
Cette typologie révèle des stratégies divergentes : certaines fermes reposent sur une forte importation d’intrants organiques, d’autres fonctionnent en autonomie avec des risques de déplétion.
L’étude montre qu’aucune relation claire n’existe entre les bilans de P calculés et l’évolution des teneurs en P, probablement parce que ces dernières dépendent de pratiques cumulées sur plusieurs décennies. Les auteurs insistent donc sur la nécessité d’une gestion stratégique du phosphore, combinantapports organiques et recyclage de ressources issues des filières agroalimentaires ou urbaines.
Conclusion
Cette recherche met en lumière l’hétérogénéité des situations et le manque d’attention porté au phosphore par de nombreux agriculteurs biologiques. Alors que l’expansion de l’agriculture biologique pourrait accentuer les tensions sur les ressources fertilisantes, développer des stratégies intégrées de gestion du phosphore apparaît essentiel pour assurer la durabilité des systèmes de production.
Pour lire l’article : https://doi.org/10.1007/s13593-025-01047-w